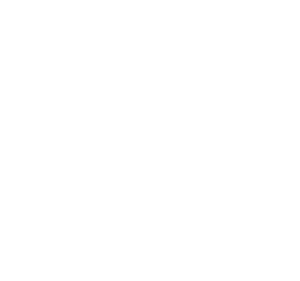Tunisie – Nawel Skandrani : « La connaissance est le premier pas vers la liberté »
« Nous existons, nous sommes vivants. Hayyou ala al Hayet ». Dans Ré-existence, sa dernière création, la danseuse et chorégraphe Nawel Skandrani ne dit rien de plus. Dès les premières minutes, elle s’installe en retrait du plateau, près du chanteur et compositeur Jawhar Basti, et n’en bougera plus jusqu’à la fin du spectacle, présenté notamment lors des dernières Journées théâtrales de Carthage (JTC). Dans son silence, ses quelques mots résonnent. D’autant plus que, chacun à sa manière, les sept jeunes interprètes – Houssemeddine Achouri, Haroun Ayari, Achraf Ben Hadj M’barek, Meriem Ben Hamida, Moayed Ghazouani, Sarra Mokaddem et Malek Zouaïdi – qui prennent bientôt possession de la scène les prolongent en partageant une bribe de leur histoire personnelle. De leur résistance par l’art. Par la danse surtout, mais aussi par le théâtre, par la musique, le cirque et la vidéo. Pièce de transmission, Ré-existence dit ainsi ce que Nawel Skandrani défend depuis une vingtaine d’années en tant que figure de proue de la danse contemporaine en Tunisie : la liberté d’expression et l’ouverture à l’autre. La rencontre des langages, des cultures.
Dans cette pièce comme dans les six autres qu’elle a créés depuis la naissance en 1997 de la compagnie qui porte son nom, le vocabulaire chorégraphique que déploient danseurs et comédiens témoigne de la richesse du parcours de Nawel Skandrani. De sa formation classique, débutée en Tunisie dans une école de danse privée puis au Conservatoire national de musique, et poursuivie en France, en Italie et aux États-Unis. De sa découverte avec Martha Graham et Merce Cunningham de la danse moderne qui se développe alors, ainsi que du modern jazz. Les expériences théâtrales qu’elle mène à son retour en Tunisie en 1988 contribuent aussi au millefeuille de Ré-existence. De même que la création, en 1992, du Ballet national qu’elle dirige pendant quatre ans. Où elle commence à se forger un style à la croisée des disciplines qu’elle n’a depuis jamais cessé de faire évoluer. De mettre à l’épreuve du présent. Car pour Nawel Skandrani, la danse participe aux grandes questions de l’époque. Elle a son mot à dire des drames comme des espoirs d’aujourd’hui.
Le Point Afrique : Dans Recapitulatio (2015), votre précédente création, vous mettiez en scène un couple solitaire, incompris, face au chaos. Des « êtres humains en manque d’amour, un territoire en manque d’Art », dites-vous sur le site internet de votre compagnie. Dans Ré-existence, vous mettez l’accent sur la faculté de transformation du monde de l’artiste. Est-ce pour vous une suite ?
Nawel Skandrani : Recapitulatio était surtout un récapitulatif de vingt ans de vie personnelle et professionnelle. Avec Sergio Gazzo, qui signe la création vidéo de mes spectacles depuis de nombreuses années, nous avons recyclé des images qui tantôt prolongeaient ce qu’exprimaient les danseurs, tantôt entraient en contradiction avec leurs gestes. Car si j’aime mêler les disciplines dans mes pièces, c’est pour en approfondir le sens. Pour y apporter non seulement de l’intensité, mais aussi de la contradiction. C’est aussi le cas dans Ré-existence, où en plus de mon complice Sergio Gazzo, je retrouve le musicien Jawhar Basti, qui a collaboré à plusieurs de mes créations et qui a composé la musique de celle-ci, qu’il joue en direct. Chaque pièce est donc un peu la suite de la précédente. Après le très personnel et intimiste Recapitulatio, j’ai eu besoin de revenir à deux éléments qui nourrissent beaucoup ma danse : le travail de troupe et la transmission.
Le désir de parler de la Tunisie de manière positive est aussi manifeste, surtout à travers les témoignages des interprètes, qui joignent les mots aux gestes. Pourquoi ce choix ?
La tendance actuelle en Tunisie, en art comme ailleurs, est à la déploration. Au misérabilisme. Or je crois que pour avancer, il faut changer de discours. Donner à voir et à entendre les personnes qui luttent pour améliorer la situation sociale, économique et politique difficile du pays – que je ne nie pas, au contraire. Les artistes en font partie. Nous avons un rôle de critique, de résistance à un contexte politique, social et culturel que l’on a espéré voir changer au moment de la révolution, mais qui reste hélas très oppressant. Et le problème ne vient pas seulement du parti islamiste Ennahda : on constate aujourd’hui que de nombreux partis dans l’opposition sous Ben Ali ont retourné leur veste. Convaincue que la résistance du quotidien que mènent de nombreux artistes et autres citoyens contre la corruption et les atteintes à la liberté d’expression sont indispensables, c’est elle que j’ai voulu faire entendre dans Ré-existence. Si le corps exprime des choses auxquelles les mots ne peuvent avoir accès, l’inverse est vrai aussi.
Voulez-vous dire qu’une forme de censure a subsisté ? Dans quelle mesure affecte-t-elle la danse ?
Si la censure était affichée sous Ben Ali, elle se poursuit sous une forme insidieuse depuis la révolution. D’une part parce que, comme je le disais plus tôt, les personnes qui dirigent le pays n’ont pas beaucoup changé, de l’autre parce que la révolution culturelle n’a pas encore eu lieu. La danse, toutefois, a été assez épargnée par les atteintes à la liberté d’expression que représentaient les comités de censure. À la différence des autres disciplines artistiques comme le théâtre et le cinéma, la danse n’était en effet pas subventionnée jusqu’en 2010. Pour le ministère, c’était donc comme si elle n’existait pas. Elle a ainsi souvent pu être plus libre, plus irrévérencieuse que les autres arts. Aujourd’hui, elle est à la même enseigne.
La subvention accordée à la danse en 2010 traduit-il un développement, et une reconnaissance de cette discipline en Tunisie ?
En 2010, c’est moi qui ai réclamé une subvention au ministre de la Culture de l’époque, le dernier du gouvernement Ben Ali. Avec quelques autres artistes, je travaillais depuis des années en Tunisie, à la fois pour créer des spectacles et pour former des danseurs. Il ne suffit pas de pouvoir dire ce qui nous tient à cœur, il faut avoir les moyens de le faire d’une belle manière, qui nous corresponde. Sans quoi les esthétiques restent figées, ce qui est encore largement le cas dans le paysage chorégraphique tunisien, qui est encore assez embryonnaire. Très peu d’artistes réussissent à s’inscrire dans la durée : certains abandonnent, d’autres décident de poursuivre leur carrière à l’étranger.
Vous êtes, en Tunisie, la chorégraphe dont les spectacles tournent le plus, sur place autant qu’à l’étranger. Comment réussissez-vous à monter vos productions ?
C’est pour chaque création un travail très lourd, qui explique en grande partie le temps que je mets pour créer une pièce. En moyenne trois ans. L’aide de l’État n’étant pas suffisante, il faut trouver soi-même des fonds. Il s’agit ensuite de trouver des lieux où jouer, et si besoin – ce qui est souvent le cas en Tunisie – de créer les conditions favorables à la réception du spectacle, où que nous jouions. En régions, non seulement les salles sont souvent mal équipées, mais la plupart du temps aucun travail n’est fait pour favoriser l’accès de la population aux œuvres présentées. Cet accompagnement est tout aussi indispensable que le fait d’aller jouer sur l’ensemble du territoire, qui, hormis la capitale, a peu accès à l’art. C’est donc la compagnie qui se charge de ce travail en allant à la rencontre d’associations et autres médiateurs susceptibles de donner envie à des gens qui, parfois, n’ont jamais vu de spectacle de danse ni de théâtre.
Votre processus de création nécessite lui aussi un temps considérable
En effet. Une fois que l’idée et la nécessité – sans lesquelles je ne fais rien – sont là, il me faut déjà du temps pour rêver la future pièce. Pour commencer à en imaginer les couleurs, les contours. C’est un moment qui fait pour moi pleinement partie de la création, même si je m’isole et m’occupe en général mes journées à des travaux très concrets, comme le jardinage. Vient ensuite le temps du choix des interprètes, qui pour des pièces de groupe comme Ré-existence peut être assez long. Car si mon équipe technique reste la même, et que j’aime retrouver de spectacle en spectacle des artistes qui me sont chers, il est difficile, voire impossible, de travailler en troupe en Tunisie. Chacun doit multiplier les collaborations pour s’en sortir, ce qui rend périlleux le simple fait de regrouper des artistes depuis la répétition jusqu’à la tournée d’une pièce. À chaque fois, il faut donc repasser par des castings et des formations. Pour Ré-existence par exemple, j’ai commencé par sélectionner 27 danseurs à qui j’ai fait donner des cours par des artistes divers. Cela m’a permis de définir la distribution du spectacle, après quoi j’ai poursuivi avec eux la formation.
Vos interprètes ont des pratiques artistiques diverses. Certains viennent du hip-hop, d’autres du classique, ou encore du jazz. Une autre est circassienne, un dernier comédien… Est-ce cette diversité qui rend nécessaire l’important travail de formation dont vous parlez ?
En partie, en effet. C’est aussi lié au fait qu’il m’est difficile de trouver des danseurs proches de mon esthétique, et même des danseurs capables de s’y adapter. La formation en Tunisie étant quasi inexistante, rares sont ceux qui ont les bases techniques nécessaires. Lacune qui est plus grave encore pour les chorégraphes. Comment créer sans connaître l’histoire et les techniques de sa propre discipline ? On ne tord le cou que de ce qu’on connaît. Et la connaissance est le premier pas vers la liberté. Il n’y a eu que quelques grands chorégraphes, qui ont inventé des langages, comme Martha Graham, Merce Cunningham, Matt Mattox pour le modern jazz, ou encore le fondateur du ballet néo-classique Georges Balanchine. Les autres, dont je fais partie, nous ne faisons qu’emprunter, que construire du neuf à partir de l’ancien. Ma formation à différentes techniques m’a permis de forger un style personnel, et c’est cette capacité que je veux transmettre.
Votre style doit aussi beaucoup à votre expérience théâtrale auprès de metteurs en scène tunisiens majeurs, Fadhel Jaïbi et Mohamed Driss
Après cinq belles années passées aux États-Unis au sein du Berkeley Ballet Theater, le théâtre s’est en effet très vite présenté à moi. Rentrée en Tunisie pour participer à un travail collectif mené par la chorégraphe Anne-Marie Sellami avec des artistes tunisiens des diasporas. Le metteur en scène Mohamed Driss a ensuite fait appel à moi en tant qu’interprète pour le spectacle Ismaïl Pacha qu’il préparait avec Taoufik Jebali, aujourd’hui directeur de El Teatro à Tunis. Cette expérience m’a passionnée et m’a conduite à décider rentrer en Tunisie. Mes liens avec le théâtre se sont en effet poursuivis. À l’époque, il y a eu un intérêt des artistes de théâtre pour la danse. Les metteurs en scène ont d’abord fait appel à des chorégraphes pour des raisons techniques. Pour ma part, je me suis vite positionnée comme créatrice, et non comme technicienne. Avec Mohamed Driss comme avec Fadhel Jaïbi, j’ai toujours essayé de servir l’imaginaire du metteur en scène ainsi que les acteurs d’une manière personnelle. La danse contemporaine tunisienne doit beaucoup au théâtre. Si elle a réussi à trouver sa place, c’est à mon avis en grande partie grâce aux metteurs en scène de cette génération.
A-t-elle, selon vous, réussi à se défaire de cette influence ?
Dans l’ensemble, les chorégraphes gardent un sentiment d’infériorité par rapport au théâtre. Le geste chorégraphique est d’ailleurs souvent qualifié de « mise en scène ». Il y a encore beaucoup à faire pour le développement et la reconnaissance de la danse en Tunisie.
Vous abordez souvent dans vos pièces des sujets de société. En 2011, vous avez même été la première artiste à créer un spectacle sur la révolution. Cet ancrage au réel est-il pour vous une manière de participer à cette évolution ?
J’ai toujours été un électron libre. Chaque création est pour moi d’abord une manière d’affirmer cette liberté, qui est bien sûr liée à ma liberté de citoyenne. À ce que je vis au quotidien. En 2011 par exemple, la regrettée Raja Ben Ammar, qui dirigeait l’espace Mad’Art à Carthage, m’avait demandé de reprendre pour un festival qu’elle organisait mon solo Les Étoiles filantes. Quand la révolution est arrivée, ça ne faisait plus sens pour moi. J’avais besoin de parler de ce qui agitait le pays, de ce qui m’animait alors. J’ai repensé à un entretien que j’avais eu avec une journaliste, Lilia Weslatly, qui s’est avérée être une blogueuse de la révolution. Nous avons créé ensemble, avec Jawhar Basti, un spectacle en douze jours que j’ai dû poursuivre seule, car Lilia a été happée par la révolution qui se poursuivait. J’y racontais entre autres des histoires qui m’étaient arrivées alors que j’étais à la tête du Ballet national, et que j’étais en conflit avec le ministre et l’administration.
On peut aussi voir dans Ré-existence un écho à la lutte que vous menez en faveur du statut de l’artiste en Tunisie. Où en est celle-ci ?
Cette question a beaucoup avancé depuis la révolution. Deux projets ont été mis au point en parallèle : l’un par le ministère de la Culture, qui a été rejeté par des groupes d’artistes indépendants dont je fais partie, l’autre par ces derniers. Celui-ci a finalement été accepté par le ministère de la Culture, mais est encore bloqué par celui des Finances. Certains députés sont aujourd’hui convaincus de la nécessité de ce statut, mais le sujet n’étant pas considéré comme une priorité, les discussions le concernant à l’Assemblée sont régulièrement reportées. Mais nous sommes patients, cela va venir.
Un Nouveau Ballet de danse tunisienne a été créé en 2017. Vous qui avez dirigé pendant quatre ans l’ancien Ballet national, qui s’est d’ailleurs dissous après votre départ, souhaiteriez-vous y participer ?
Je me poserais peut-être la question si l’on me sollicitait. Ça n’a pas été le cas jusque-là. De nombreuses erreurs ont à mon avis été commises jusqu’à maintenant avec ce Ballet. Avant de monter tout de suite des créations, mieux aurait valu déjà se concentrer sur la formation. Après tant d’années sans Ballet national, ils n’étaient pas à une année près. Je rêve de pouvoir mener un travail de troupe, avec une équipe permanente, mais je ne vois aujourd’hui pas tellement de possibilités en la matière. Mais je ne perds pas courage, jamais.
Sorry, the comment form is closed at this time.